Le choix du logement ou de l’hébergement est une étape essentielle dans le parcours des personnes âgées en perte d’autonomie. L’objectif est de garantir un cadre de vie sécurisé, confortable et adapté aux besoins spécifiques de chacun, tout en favorisant le maintien des liens sociaux et l’autonomie.
Les EHPA sont des structures d’accueil collectif destinées à des personnes âgées encore autonomes ou faiblement dépendantes, qui ne relèvent pas d’un accompagnement médical ou soignant constant.
Les EHPA ne disposent pas d’un plateau médical permanent ni d’un personnel soignant sur place en continu. Ils offrent néanmoins un environnement sécurisé, une vie sociale partagée, et des services collectifs (restauration, animation, veille, entretien des locaux).
Public :
- Personnes âgées de plus de 60 ans, autonomes ou avec une dépendance légère (GIR 5 ou 6 en général).
- Souhaitant rompre l’isolement, vivre dans un cadre plus sécurisé, sans aller jusqu’à l’entrée en EHPAD.
- En recherche d’un logement adapté avec des services collectifs, tout en gardant leur liberté de vie.
Services proposés
- Logement privatif (chambre ou petit studio meublé, avec sanitaires).
- Repas en commun, blanchisserie, animations collectives, espaces partagés.
- Présence quotidienne du personnel non soignant (agents d’accueil, animateurs…).
- Aucune surveillance médicale permanente, mais possibilité de faire intervenir des professionnels de santé libéraux.
Financement
Le coût est à la charge de la personne âgée, mais peut être allégé par :
- L’APL ou ALS (selon les ressources, si l’établissement est conventionné),
- L’aide sociale à l’hébergement, si les revenus sont insuffisants,
- D’autres aides ponctuelles (caisse de retraite, mutuelle…).
Certaines résidences autonomie étaient auparavant désignées comme EHPA, mais le terme EHPA peut encore désigner des structures non médicalisées en attente de transformation en résidence autonomie.
Pour être bien orienté, il est recommandé de passer par une structure d’informations et d’orientation.
Les EHPAD sont des établissements spécialisés dans l’accueil des personnes âgées qui ne peuvent plus vivre de manière autonome. Ils offrent une prise en charge médicale et une assistance quotidienne pour les actes de la vie courante.
Caractéristiques :
- Prise en charge médicale : Soins infirmiers, surveillance médicale régulière, prise en charge des pathologies chroniques et des soins palliatifs.
- Accompagnement personnalisé : Aide pour les repas, la toilette, les déplacements, la gestion des médicaments, etc.
- Activités thérapeutiques et récréatives : Des activités sont proposées pour stimuler les résidents et maintenir leur lien social (ateliers, loisirs, etc.).
- Sécurité et surveillance : Présence de personnel médical et paramédical 24h/24 et dispositifs d’urgence.
Public :
- Personnes âgées en situation de dépendance importante, nécessitant des soins quotidiens et un accompagnement médical permanent.
- Les EHPAD sont souvent recommandés pour les seniors souffrant de maladies graves ou dégénératives.
Financement et aides possibles :
- L’APA peut être utilisée pour financer une partie des frais d’hébergement et de soins en EHPAD si ce dernier est conventionné, selon le niveau de dépendance (GIR 1 à 4).
- Aide sociale à l’hébergement (ASH) : Si le résident ne peut pas payer la totalité de l’hébergement, l’ASH peut couvrir le solde, sous conditions de ressources.
Pour être bien orienté, il est recommandé de passer par une structure d’informations et d’orientation.
Les PASA sont des espaces spécialisés au sein des EHPAD, destinés à l’accueil en journée des résidents souffrant de troubles cognitifs modérés, comme la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés. Leur objectif est de proposer un environnement sécurisé, stimulant et apaisant, en dehors de leur lieu d’hébergement habituel, pour maintenir ou améliorer leur autonomie et leur qualité de vie.
Caractéristiques
- Accueil en journée
- Capacité limitée : 12 à 14 personnes maximum pour garantir un accompagnement individualisé.
- Encadrement par une équipe pluridisciplinaire formée aux troubles cognitifs : aides-soignants, assistants de soins en gérontologie, psychomotriciens, ergothérapeutes, psychologues…
- Activités adaptées : stimulation cognitive, ateliers mémoire, activités motrices, ateliers cuisine, jardinage, jeux, etc.
- Objectif : favoriser le maintien des capacités restantes, prévenir les troubles du comportement et améliorer la qualité de vie des résidents.
Pour qui ?
- Personnes âgées résidant déjà en EHPAD, souffrant de troubles neuro-évolutifs modérés (Alzheimer, apparentés), sans comportements majeurs d’agitation ou d’opposition.
- Ayant besoin d’un accompagnement renforcé en journée, mais ne relevant pas d’une unité protégée.
Une évaluation de l’état de santé et des besoins est réalisée par l’équipe médicale de l’EHPAD pour déterminer l’éligibilité.
Coût et prise en charge
L’accès au PASA n’engendre pas de surcoût pour les résidents : les activités et l’accompagnement sont inclus dans les forfaits soins financés par l’Assurance Maladie.
Aucune démarche spécifique n’est à réaliser par la famille ; c’est l’équipe soignante qui propose et organise la participation du résident.
À savoir
- Le PASA n’est pas une structure extérieure, mais un service intégré à un EHPAD, aménagé dans un espace distinct et sécurisé.
- Il ne s’agit pas d’un accueil de jour ouvert à l’extérieur : seuls les résidents de l’EHPAD peuvent y accéder.
Pour être bien orienté, il est recommandé de passer par une structure d’informations et d’orientation.
Les unités de vie Alzheimer sont des sections au sein d’un EHPAD ou des établissements spécifiques qui sont dédiés aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles cognitifs graves. Ces unités offrent un environnement sécurisé et adapté aux besoins des patients, avec un personnel formé spécifiquement pour prendre en charge les troubles du comportement et la perte de mémoire.
Caractéristiques :
- Environnement sécurisé : Les unités sont souvent fermées pour garantir la sécurité des résidents (prévention des fugues, chute).
- Prise en charge spécialisée : Le personnel médical et soignant est spécialement formé à la gestion des troubles comportementaux liés à la démence, et propose des activités de stimulation cognitive.
- Accompagnement personnalisé : Suivi des traitements et des thérapies adaptées à la progression de la maladie.
Public :
- Personnes âgées atteintes de démence ou maladie d’Alzheimer en stade modéré à avancé.
- Ces unités sont destinées aux personnes ayant des troubles cognitifs graves qui ne peuvent plus être exécutées à domicile ou dans un environnement non spécialisé.
Pour être bien orienté, il est recommandé de passer par une structure d’informations et d’orientation.
Les Petites Unités de Vie (PUV) sont des structures médico-sociales d’hébergement pour personnes âgées en perte d’autonomie, qui offrent un cadre de vie plus souple, plus familial et à échelle humaine. Conçues pour accueillir un nombre réduit de résidents (souvent moins de 25), elles proposent des logements privatifs, un accompagnement 24h/24, des espaces communs conviviaux, et des activités du quotidien partagées (repas, jardinage, animation…). Leur petite taille permet une personnalisation des accompagnements et favorise un sentiment de sécurité et de proximité. Les soins médicaux ou infirmiers y sont assurés par des professionnels libéraux ou des intervenants extérieurs.
Public concerné
Les PUV s’adressent principalement :
- Aux personnes âgées de plus de 60 ans ;
- En perte d’autonomie modérée à importante (GIR 1 à 4) ;
- Pour qui le maintien à domicile devient difficile, sans pour autant nécessiter une entrée en EHPAD classique.
Elles sont particulièrement adaptées aux zones rurales ou isolées, où elles représentent une solution de proximité et de lien social.
Modalités de financement
Comme les EHPAD, les PUV appliquent une tarification en trois volets :
- Le tarif hébergement, à la charge du résident, pouvant être partiellement pris en charge par l’APL ou l’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH) selon les ressources ;
- Le tarif dépendance, finançable via l’APA en établissement ;
- Le tarif soins, pris en charge par l’Assurance Maladie, selon les interventions prescrites.
Le coût est généralement moins élevé qu’en EHPAD, mais dépend des prestations proposées par l’unité.
Pour être bien orienté, il est recommandé de passer par une structure d’informations et d’orientation.
Les UHR sont des structures spécifiques au sein des EHPAD, mais peuvent également être mises en place dans des structures de type EHPAD hors les murs ou dans des établissements adaptés, dans le but de répondre à des besoins spécifiques en termes de prise en charge. Ces unités sont destinées aux personnes âgées souffrant de troubles cognitifs avancés ou d’autres formes de démence, et nécessitant une surveillance accrue et un accompagnement personnalisé.
Caractéristiques :
- Accompagnement spécialisé : Les UHR sont des espaces de vie protégés au sein des établissements, conçus pour offrir un environnement sécurisé et apaisant aux personnes âgées présentant des troubles du comportement ou de la mémoire. Ces unités sont spécialement adaptées pour accueillir les résidents souffrant de maladies neurodégénératives.
- Sécurité renforcée : Les UHR mettent en place des dispositifs de sécurité pour prévenir les risques de fugue ou de chute, tout en offrant un cadre de vie le plus proche possible de celui d’un domicile classique. Ces unités sont souvent équipées de portes sécurisées, de caméras de surveillance, et d’un personnel formé spécifiquement aux soins des personnes atteintes de troubles cognitifs.
- Encadrement adapté : L’encadrement dans une UHR est renforcé avec la présence de professionnels formés pour gérer les troubles cognitifs, de comportement ou de communication. Cela inclut des aides-soignants, des infirmiers, des psychologues, des psychomotriciens, et des animateurs spécialisés dans l’accompagnement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives.
- Soins et activités : Des soins médicaux adaptés sont prodigués dans ces unités, mais aussi des activités stimulantes et thérapeutiques visant à maintenir l’autonomie, la mobilité, et à favoriser le bien-être des résidents. Des activités cognitives, physiques et sensorielles sont proposées pour stimuler la mémoire, la créativité, ou la sociabilité.
Conditions d’attribution :
- La personne doit avoir un haut niveau de dépendance, en général dans les groupes GIR 1 à 3 selon la grille AGGIR, ce qui correspond à une incapacité importante à réaliser les actes de la vie quotidienne.
- La personne doit souffrir de troubles cognitifs importants (par exemple, maladie d’Alzheimer ou autre forme de démence), nécessitant une surveillance continue et une prise en charge spécifique.
- Un avis médical, souvent d’un gériatre ou d’un neurologue, est nécessaire pour confirmer la nature des troubles cognitifs et déterminer si une UHR est la solution la plus appropriée pour la personne âgée.
- En fonction de l’évaluation réalisée, le médecin traitant ou un établissement de santé pourra recommander l’admission dans une UHR.
Pour être bien orienté, il est recommandé de passer par une structure d’informations et d’orientation.
L’objectif principal des USLD est de fournir des soins médicaux continus aux personnes âgées en perte d’autonomie sévère et présentant des pathologies complexes. Ces structures visent à offrir une prise en charge de qualité et un accompagnement adapté aux besoins des résidents, qu’ils soient liés à une maladie neurodégénérative, des pathologies chroniques lourdes ou des soins palliatifs.
Caractéristiques :
- Les USLD sont dotées de personnels médicaux spécialisés qui assurent une prise en charge médicale complète. Les soins sont souvent intensifs et continus, adaptés à des pathologies complexes.
- L’admission en USLD est généralement réservée aux personnes ayant des besoins de soins constants. Ces soins peuvent inclure la gestion de la douleur, des soins de nursing, et des traitements thérapeutiques complexes.
- Comme pour les EHPAD, les USLD proposent un hébergement permanent avec des infrastructures adaptées pour répondre aux besoins des résidents (chambres médicalisées, équipements spécialisés, etc.).
- Les USLD sont souvent adaptées aux personnes âgées souffrant de maladies chroniques graves, dont l’évolution nécessite des soins médicaux constants et une surveillance étroite.
Conditions d’Admission :
- L’admission en USLD est généralement destinée aux personnes âgées présentant un GIR 1 à 3.
- Les USLD accueillent des résidents souffrant de maladies graves, chroniques, neurodégénératives ou de pathologies terminales nécessitant des soins médicaux constants.
- L’admission en USLD est soumise à une évaluation médicale réalisée par le médecin traitant ou un gériatre. Cette évaluation permet de déterminer si l’état de santé de la personne justifie un accueil en soins de longue durée.
- Le besoin d’un soin médical intensif doit être avéré. De plus, des critères sociaux sont également pris en compte, en particulier si la personne âgée ne peut pas bénéficier d’un maintien à domicile ou dans un autre type de structure, comme un EHPAD ou une unité Alzheimer.
Aides possibles :
- Allocation Personnalisée d’Autonomie
- Aide sociale à l’Hébergement
- Assurance complémentaire santé : rapprochez vous de votre organisme
Tarification des soins :
Les USLD sont généralement financées par la Sécurité sociale, mais une partie du coût peut être à la charge de la personne âgée et de sa famille, selon les ressources disponibles. La tarification dépend du niveau de soins nécessaires et de la dépendance de la personne.
Pour être bien orienté, il est recommandé de passer par une structure d’informations et d’orientation.
L’accueil familial est une alternative conviviale à l’hébergement en établissement, destinée aux personnes âgées ne pouvant ou ne souhaitant plus vivre seules à domicile. Il permet à une personne en perte d’autonomie d’être accueillie au domicile d’un accueillant familial agréé, dans un cadre de vie chaleureux, sécurisé et à taille humaine.
Ce dispositif est encadré par la CTM, qui délivre les agréments et contrôle la qualité de l’accueil proposé.
Pour qui ?
- Personnes âgées en perte d’autonomie, mais ne relevant pas de soins médicaux lourds.
- Personnes seules, fragilisées, isolées ou ayant besoin d’un accompagnement au quotidien.
- Il peut s’agir d’un accueil permanent, temporaire (suite d’hospitalisation, répit…), ou à temps partiel (accueil séquentiel).
Ce que l’accueil familial permet :
- Un accompagnement personnalisé dans un cadre familial.
- Une vie en petit comité (1 à 3 personnes maximum accueillies).
- Une surveillance quotidienne, des repas, une aide à la toilette, des activités simples…
- Des liens sociaux maintenus dans un environnement rassurant.
Encadrement et sécurité :
- L’accueillant est formé, agréé et contrôlé.
- Un contrat d’accueil est signé entre la personne âgée (ou son représentant légal) et l’accueillant.
- Le tarif est fixé par le contrat, avec possibilité de prise en charge financière (APA, aide sociale à l’hébergement, etc.).
La liste des accueillants familiaux agréés n’est pas publiée en ligne afin de garantir une orientation adaptée à chaque situation.
Pour être bien orienté, il est recommandé de passer par une structure d’informations et d’orientation.


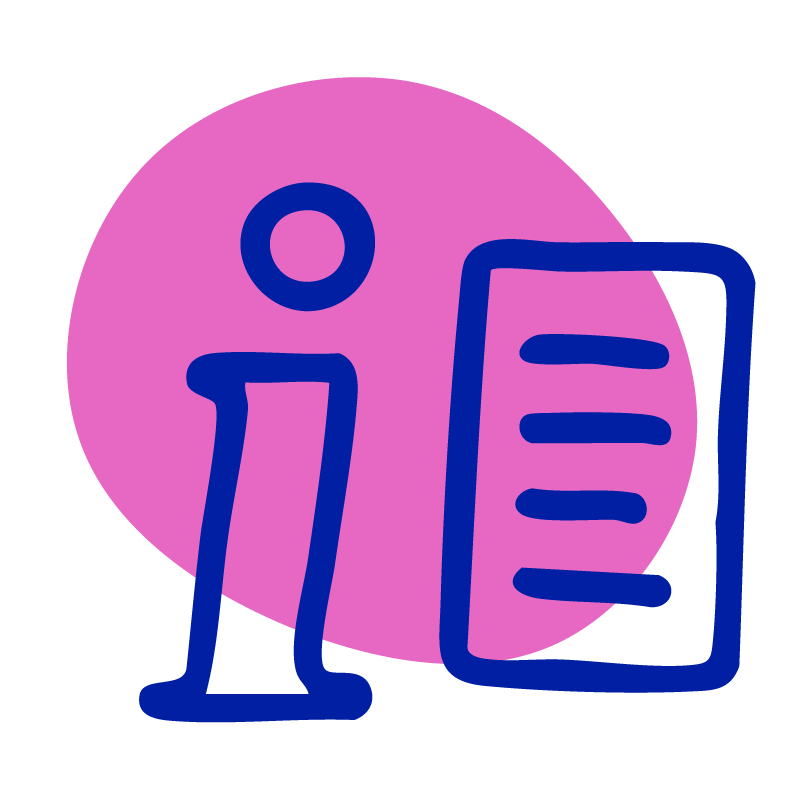 Informations, ressources et droits
Informations, ressources et droits Santé et soins
Santé et soins Maintien à domicile
Maintien à domicile Répit des aidants
Répit des aidants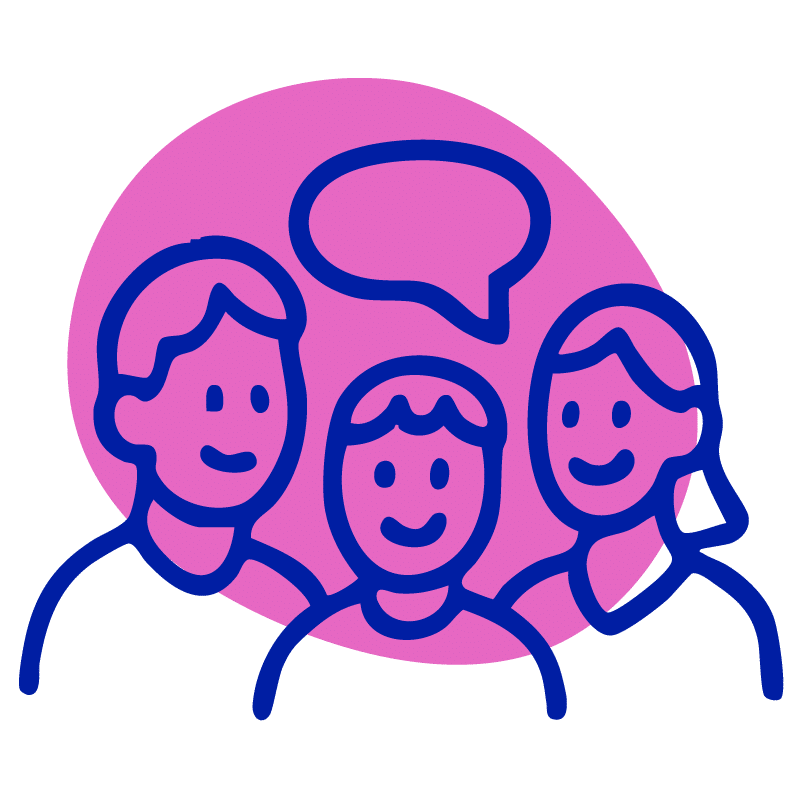 Vie sociale
Vie sociale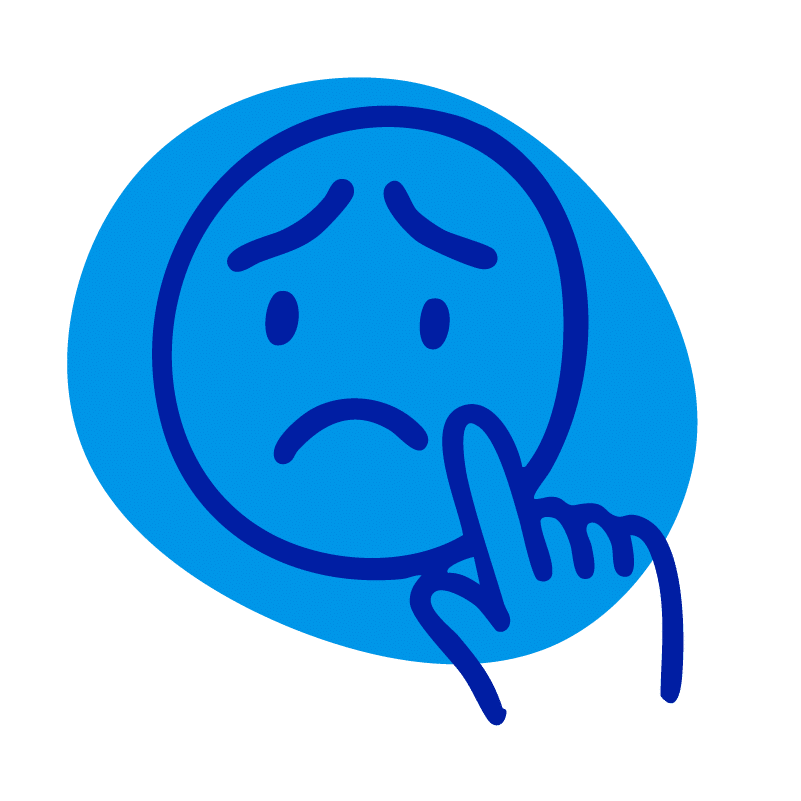 Maltraitance et vulnérabilité
Maltraitance et vulnérabilité